: Depuis le 24 février 2011, le Burkina Faso connaît une crise qui a troublé la quiétude de l’ensemble des populations. Sociale, politique et institutionnelle, cette crise a mis à nu de nombreux aspects du fonctionnement de l’appareil institutionnel du pays. Le Pr Augustin Loada, enseignant de droit à l’université de Ouagadougou et Directeur du Centre pour la gouvernance démocratique (CGD), dans la présente interview, donne la lecture du juriste qu’il est de cette crise. Il s’appesantit sur les conséquences de la crise, situe quelques responsabilités et fait des propositions aux politiques afin de sortir le pays de ce bourbier. Il s’interroge par ailleurs sur le message donné par la crise. Les politiques l’ont-ils compris ?
"Le Pays" : Quel commentaire faites-vous de la nomination du nouveau Premier ministre ainsi que de la composition de son gouvernement ?
Pr Augustin Loada : En ce qui concerne la nomination du nouveau gouvernement, je pense que beaucoup d’analystes et d’observateurs ont été surpris du choix qui a été porté sur la personne de Luc Adolphe Tiao. Tout le monde salue ses qualités professionnelles de communicateur, mais je crois que beaucoup ne l’attendaient pas à ce poste-là. Le chef de l’Etat seul sait pourquoi il l’a choisi. N’empêche que le chef de l’Etat l’a désigné et donc selon lui, Luc Adolphe Tiao est l’homme de la situation. Il a peut-être analysé la problématique qui se pose au Burkina en termes de déficit de communication. Il a cru comprendre qu’en nommant un communicateur, cela permettrait de mieux communiquer au niveau du pouvoir sur les priorités et les actions à conduire, et que cela permettrait aussi de rassurer les populations. Je n’ai pas de jugement à porter sur le choix de la personne parce que ce sont forcément des critères politiques qui prévalent au-delà des qualités professionnelles des uns et des autres. Ce que l’on peut souhaiter, c’est qu’il ramène la paix sociale au Burkina. Je parle en tant que citoyen parce que tous les Burkinabè en ont bien besoin.
Un gouvernement d’ouverture avait été annoncé par le Premier ministre. Qu’en dites-vous ?
Le Premier ministre avait annoncé un gouvernement d’ouverture. Oui. Beaucoup ont pensé que l’ouverture signifiait ouverture envers l’opposition mais nous constatons que dans ce gouvernement, il n’y a pas de responsables de l’opposition avérée et institutionnelle et donc en termes d’ouverture, les attentes de l’opinion n’ont pas été véritablement satisfaites, s’il y avait des attentes de ce point de vue. Mais je me dis qu’ils ont évalué la situation et considéré que pour faire face à cette problématique, il valait mieux ne pas trop ouvrir. Ce sont des appréciations qui me sont propres.
Le constat en termes de genre fait état d’un nombre réduit de femmes au sein du gouvernement...
C’est un constat que beaucoup d’observateurs ont établi mais, vous savez très bien que nous sommes en situation de crise. En période d’accalmie, on pouvait être plus exigeant en termes d’attente. La priorité de ce gouvernement, c’est d’éteindre l’incendie. Ils n’ont peut-être pas eu le temps de rechercher l’équilibre auquel nous sommes attachés en période d’accalmie. C’est certainement la situation qui a dicté ces choix-là.
A y voir de près, le Premier ministre avait parlé de compétences. Pensez-vous qu’il a composé librement ce gouvernement ?
Je n’en sais rien. De toutes façons, quand j’ai entendu parler de compétences, je sais très bien qu’il y a plusieurs compétences et à mon avis, c’est la compétence politique qui prévaut parce qu’on ne peut pas dire que ceux qui sont partis sont moins compétents. De mon point de vue, ce critère me paraît discutable. Par rapport à une situation comme celle-ci, il y a des attentes au niveau de l’opinion. Je pense que répondre aux attentes de l’opinion me paraît plus judicieux que de chercher à composer un gouvernement sur des critères qui, de toutes les façons, seront discutables. Je le dis parce que la personne que vous choisissez, si elle ne répond pas aux attentes de l’opinion, vos critères de compétences et de professionnalisme tombent à l’eau. Donc pour moi, ce qui est important, c’est que ce gouvernement réponde aux attentes de l’opinion. Peu importe qui le gouvernement choisit.
Avec le recul, quelle analyse faites-vous de cette crise qui secoue le Burkina ?
J’ai l’impression que cette crise est venue avec une soudaineté telle qu’elle a surpris beaucoup d’observateurs et même le pouvoir qui ne s’attendait pas à un tel basculement. Il y a quelques mois encore, le Burkina vivait sur un nuage. On parlait d’émergence, on nous promettait de poser les bases d’une émergence où le Burkina rejoindrait le groupe de pays appelé "BRICS", c’est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. C’était très ambitieux. Peut-être que la magie de la médiation de notre chef d’Etat, les succès diplomatiques que le Burkina a engrangés, le sens géostratégique et géopolitique de notre chef d’Etat ont créé l’illusion que le Burkina serait en train de décoller sous son leadership. Et voilà brutalement que quelques semaines, après le départ de Laurent Gbagbo, tout s’emballe, parce que c’était quand même un alibi à un certain nombre de choses que nous avons constatées au Burkina. C’est le cas par exemple des délestages où l’on nous expliquait que c’est à cause de la crise en Côte d’Ivoire que nous étions sevrés d’électricité.
Aussi, c’est grâce à la crise en Côte d’Ivoire que la parenthèse de l’affaire Norbert Zongo s’est refermée rapidement parce que les Burkinabè se sont retrouvés derrière leur chef de l’Etat. C’est un facteur qui a pu jouer. Cet alibi n’existe plus. Brutalement, il y a un basculement qu’on constate dans notre pays qui entre dans l’oeil du cyclone. Aussi, le contexte régional et international a beaucoup desservi le pouvoir en place. Les Burkinabè ont vu ce qui s’est passé en Tunisie, en Egypte et ils voient ce qui se passe en Libye et maintenant en Syrie. Ils voient les images. Il y a l’effet de contagion qu’il ne faut ni sous-estimer, ni négliger. Mais je pense que les facteurs les plus déterminants de cette crise sont à rechercher au plan interne. Il y a eu une accumulation de situations qui ne pouvait déboucher que sur la révolte.
A la présentation de l’ouvrage collectif qui portait sur les révoltes sociales au Burkina, certains auteurs ont expliqué que c’est l’absence de possibilité d’expression institutionnelle, d’être entendu, écouté et la non prise en compte des points de vue qui conduisent à des expressions protestataires hors système, notamment dans la rue. Si vous prenez par exemple les étudiants, ils vous disent que c’est plus efficace de brûler un pneu sur le boulevard Charles De Gaulle que de s’asseoir autour d’une table de négociations avec les autorités pour faire prévaloir un certain nombre de revendications. On a donc l’impression d’être dans un système de gouvernance où les autorités ne prennent pas en compte les attentes sociales de telle sorte qu’une partie de la population pense que la meilleure manière de se faire entendre est de s’exprimer sur le mode protestataire, le plus souvent, sur le mode de la révolte.
Je pense que c’est ce cheminement qui a été observé au niveau de l’armée. Certainement que ces mutineries auxquelles nous avons assisté sont la manifestation de problèmes internes. Comme il n’y a pas eu de mécanismes pour gérer ces problèmes, ils se sont manifestés de la manière la plus brutale, c’est-à-dire sous la forme d’une mutinerie avec tous les excès et exactions auxquels nous avons assisté et qui sont indignes d’une armée républicaine.
La forme de contestation au Burkina ressemble-t-elle à celle de la Tunisie ?
J’ai dit que l’effet de contagion n’est pas à négliger et cela ne date pas d’aujourd’hui. Avec les processus démocratiques de la fin des années 1980 début 1990, le phénomène de contagion a pu jouer dans un certain nombre de pays. Mais, la dynamique interne me paraît plus explicative que la dynamique externe. Si l’on veut comprendre pourquoi, il faut rechercher les causes beaucoup plus à l’interne : la façon dont les affaires publiques sont traitées dans ce pays. Je pense que cette accumulation de problèmes non traités, aussi bien dans l’univers scolaire qu’universitaire et dans le monde militaire a créé ce décloisonnement. Les élèves et les étudiants ont commencé un mouvement protestataire qui a été suivi au niveau de l’armée. Les facteurs déclenchants peuvent être anecdotiques. Voyez : la première guerre a commencé par un attentat à Sarajevo, un facteur qui peut paraître anodin mais qui a plus enclenché un certain nombre de mouvements par la suite qu’il était très difficile de contrôler. Personne ne pouvait imaginer que le décès de l’élève Justin Zongo entraînerait un mouvement protestataire.
La longévité au pouvoir peut-elle être une des raisons de la révolte ?
Je pense que c’est l’un des enjeux fondamentaux de cette crise. Qu’on le veuille ou pas, c’est un système qui est en place depuis pratiquement un quart de siècle et plus. Vous savez qu’en Afrique, les systèmes de gouvernance reposent sur des individus. Blaise Compaoré, qu’on le veuille ou pas, est sur la scène politique depuis le milieu des années 80. En ce moment, nous étions encore au lycée. Quand en 1983, Blaise Compaoré a dirigé les opérations militaires pour le 4 août 1983, moi j’étais en seconde. Et j’étais à l’université en 1987 quand il a pris le pouvoir. Mes enfants vont bientôt voter parce qu’ils vont atteindre l’âge de 18 ans, et toujours Blaise Compaoré comme alternative.
Je veux bien que l’on me dise qu’il y a des hommes providentiels mais à un certain moment, ils perdent de leur charisme et c’est ce que nous appelons l’usure du pouvoir que les intéressés, le plus souvent, ne veulent pas reconnaître et qui sont des phénomènes sociologiques à prendre en compte. Qu’il s’agisse de régime démocratique ou de régime semi-démocratique, à un certain moment, le président ou le Premier ministre perd de son charisme même dans les pays que nous considérons comme modèles (la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis). Il connaît une chute spectaculaire dans les enquêtes d’opinion, ce qui met son autorité à mal. De la même façon, cette usure joue, même dans les régimes autoritaires.
Y a-t-il un problème juridique qui se pose quand, dans le pays, les militaires prennent les armes et que les magistrats suspendent leurs activités ?
Je pense que cette crise a montré que ce qui est en jeu, c’est la gouvernance démocratique. C’est clair qu’il y a des revendications qui ne sont pas ouvertement formulées du côté de ceux qui sont dans la rue, mais c’est clair que du côté des partis politiques de l’opposition et des OSC (Organisations de la société civile), il y a des revendications en termes de démocratisation qu’il faut prendre en compte dans le schéma de sortie de crise. Il y a donc cela et puis, qu’on le veuille ou pas, les revendications corporatistes qui se sont manifestées chez les militaires mettent à nu le système de gouvernance. C’est donc la manière de gérer les affaires publiques qui conduit à cette situation.
Le système de gouvernance actuel est en cause. Il ne faudrait pas que les autorités se trompent de diagnostic. Même si certains ne veulent pas ouvertement poser les termes du débat, moi je pense qu’au niveau des OSC, il faut une démocratisation sincère dans ce pays, qui fait que les dirigeants soient comptables devant la population. C’est cela aussi la démocratie : que l’on sanctionne les dirigeants s’ils ont failli à leurs obligations d’apporter un bien- être aux populations ; il faut que de telles situations soient en mesure d’être sanctionnées sinon il n’y a pas de démocratie ni de bonne gouvernance.
Alors, quelles que soient les performances des dirigeants ou leur capacité, s’ils sont là et n’ont pas de compte à rendre, il ne faut pas s’attendre à une légitimité devant les populations. Les élections peuvent donner l’illusion que tout va bien. Ben Ali a été élu à 80%, Moubarak aussi ; donc pour moi, ça ne veut rien dire. Quand on regarde les résultats des dernières élections, Blaise Compaoré a été élu, sur une population de 14 millions, par à peine 1 300 000, ce qui est l’équivalent de la population de Ouagadougou. En terme de légitimité, on ne peut pas s’appuyer sur le fait que 80% des électeurs aient choisi le président pour considérer que cela est un blanc seing. Je pense qu’à ce niveau, c’est se tromper de diagnostic.
Quel est votre commentaire sur l’attitude des magistrats ?
Sur cette situation, il y a d’abord la justice qui était dans l’oeil du cyclone puisque des décisions de justice ont été ouvertement contestées par des citoyens même s’ils sont des militaires. C’est la première fois que l’on voit cela. Donc dans le principe, ce n’était pas recevable dans un Etat de droit. On ne peut pas accepter que des militaires qui ont été condamnés refusent de se soumettre à la justice. Il y avait des possibilités offertes par la procédure judiciaire ou alors parce qu’ils n’avaient peut-être pas confiance au système judiciaire. Un certain nombre de militaires ont posé des actes véritablement regrettables dans un Etat de droit. Les magistrats ont eu raison de marquer le coup, de dire que c’est une atteinte à l’Etat de droit, une atteinte grave au constitutionnalisme qui consacre l’égalité citoyenne, le droit pour tout citoyen d’être entendu par une juridiction impartiale.
De ce point de vue, les magistrats étaient dans leur droit, dans leur rôle, quand ils ont cessé le travail pour protester contre cette atteinte à l’Etat de droit. Je constate que dans la gestion de cette crise, il n’y a pas eu de clarté du côté du gouvernement. Je me demande par exemple, jusqu’à présent, quelle est l’autorité qui nous impose le couvre-feu. Tantôt j’entends des références au chef d’Etat-major général, tantôt à un Secrétaire général de ministre, tantôt une lettre du Premier ministre. Conformément à la Constitution, lorsqu’il y a une situation de nature à entraver le bon fonctionnement des institutions, comme c’est le cas, le Président du Faso aurait dû prendre des mesures beaucoup plus idoines et je pense en partie, en particulier, au pouvoir de crise que lui confère la Constitution.
Ce qui aurait permis à l’Assemblée nationale de se réunir de plein droit et d’apprécier aussi la situation parce que nous n’avons pas du tout entendu cette institution dans la gestion de cette crise. Bien sûr, le président de l’institution s’est exprimé, mais j’estime que ce n’est pas à la hauteur du forfait auquel on a assisté. Je m’attendais à ce que l’Assemblée se réunisse pour apprécier la situation et prendre les dispositions appropriées. Je m’interroge d’autant plus qu’il y a une commission chargée des affaires étrangères et de la défense. Comment ces mécanismes ont pu fonctionner sans voir qu’il y a des problèmes dans notre armée et que c’était de leur devoir aussi de contribuer à résoudre ces problèmes ?
C’est une crise qui a montré une faillite totale des institutions démocratiques. Je ne vois pas d’autres alternatives que de renforcer ces institutions aux travers d’un dialogue démocratique et sincère qui réunirait autour de la table, l’opposition dans toutes ses sensibilités, qu’il s’agisse de l’opposition institutionnelle ou de l’opposition hors système parce qu’elle a des revendications à faire valoir. Je pense aux questions d’impunité. Il y a des gens dans ce pays qui se battent véritablement pour qu’il n’y ait plus d’impunité. Ce sont des demandes à prendre en compte. Il y a ceux qui demandent que les candidatures individuelles et indépendantes soient reconnues. Ce sont des revendications légitimes. Bien entendu, il y a les refondateurs qui ont fait des recommandations, mais, je pense qu’on ne peut pas faire un dialogue démocratique sincère pour sortir de cette crise, si on ne prend pas comme référence le rapport du MAEP qui est un exercice fait à la demande du chef de l’Etat.
Je ne comprends pas pourquoi ce rapport n’est pas au centre du débat. On n’a pas aussi suffisamment exploité les possibilités offertes par le rapport du Collège de sages. Le processus a été verrouillé et les recommandations ont été mises en oeuvre de manière partielle et partiale. Si ce processus avait été suivi de manière complète, nous n’en serions pas là parce qu’on constate que dix ans après, ce sont les mêmes problèmes qui se posent. Nous sommes obligés de nous poser la question : est-ce que le pouvoir veut sortir véritablement, de manière durable, de cette situation potentiellement explosive où tous les dix ans, le Burkina se demande s’il basculera dans l’horreur ou s’il continuera à faire des progrès sur le plan économique, social et démocratique ?
Après avoir gâché la première opportunité à la fin des années 1990 avec la crise consécutive à l’affaire du journaliste Norbert Zongo, je pense que cette deuxième fenêtre ne doit pas être gâchée et doit être saisie aussi bien par les tenants du pouvoir que par l’opposition pour qu’une dernière fois, les Burkinabè puissent trouver des solutions durables à la crise de gouvernance qui perdure dans notre pays.
Est-ce que juridiquement, on peut relever qu’il y avait vacance du pouvoir lorsque le président du Faso avait quitté le palais présidentiel suite aux tirs de la Garde présidentielle ?
Il est clair que sur le plan politique, un mythe est tombé. Mais, je ne pense pas que le fait que le président du Faso ait quitté le palais momentanément signifie qu’il y a vacance du pouvoir. Il est toujours au poste puisqu’il a été élu par les Burkinabè, même si on a beaucoup à redire sur la manière dont cela s’est passé.
Le pouvoir gère-t-il bien la crise ; la formation d’un nouveau gouvernement est-elle la solution ?
Le gouvernement vient d’être installé et attendons de voir. Nous sommes au début de la gestion de la crise. Mais, les signes qui sont donnés ne sont pas très encourageants parce que le fameux ministère d’Etat chargé des réformes politiques, est à mon avis un nouveau signal. Je m’attendais à ce que celui-ci n’existât plus. Il faut que les Burkinabè cessent de penser que le Burkina est un pays à part. L’expérience des autres pays montre que quand vous voulez faire des réformes qui recueillent le consensus, il ne faut pas commencer par verrouiller le processus. Il y a suffisamment de sages dans ce pays qui ont une certaine hauteur de vue, qui aiment leur pays, et à qui on aurait pu tout simplement demander de faire le tour d’horizon de propositions qui existent, d’en faire une synthèse, de les proposer au chef de l’Etat et à partir de cela, on fait un dialogue.
Et que dites-vous du ministère de la Défense que s’est octroyé le chef de l’Etat ?
Dans un premier temps, je peux expliquer cela par le fait qu’il n’a peut-être pas trouvé de personne compétente en qui il fait confiance pour gérer ce ministère. La deuxième hypothèse peut être symbolique, pour montrer qu’il accorde de l’importance à ce volet. Mais est-ce à dire que pour les autres secteurs ministériels, il n’accorde pas beaucoup d’importance ? Enfin, cela nous montre peut-être clairement le vrai visage du régime à savoir, qu’on le veuille ou pas, que l’un de ses ressorts essentiels, c’est l’armée. Cela permet aussi de nous rappeler que c’est quand même un militaire.
Face à cette situation, est-il toujours opportun de parler de l’article 37 ?
J’espère qu’ils ont compris que ce qui est véritablement en cause, c’est la crise du système de gouvernance qui est en place dans notre pays. Un système qui fonctionne sur la base du "continuisme", la permanence au pouvoir et dont la préoccupation essentielle est d’empêcher l’alternance. Que ce soit au sein de la majorité ou au niveau du changement de rôle qui existe dans toute démocratie qui se respecte à savoir qu’un jour, la majorité peut se retrouver dans l’opposition et celle-ci au pouvoir. S’ils ne l’ont pas compris, toutes les mesures qui seront prises ne seront tout simplement que du cataplasme sur une jambe de bois et nous allons devant des problèmes.
C’est la permanence ou pouvoir d’un même système qui empêche ce système et la société de respirer et empêche la circulation des élites. Dans une société où il n’y a pas de circulation d’élites, cela crée un certain nombre de frustrations et d’injustice. Quand le président du Faso a appelé à des réformes et les agitations autour de la limitation du mandat présidentiel a été violemment contestée par les tenants du pouvoir, nous avons compris que c’était l’enjeu fondamental de l’appel lancé par le chef de l’Etat. Cela doit faire partie du dialogue et qu’ils nous expliquent pourquoi ils tiennent tant à rester au pouvoir. Si c’est la sécurité, la tranquillité et la paix qu’ils recherchent, cela peut se discuter. Je pense que Blaise Compaoré a suffisamment apporté à ce pays.
Bien sûr que toute oeuvre humaine n’est pas parfaite et au nom des acquis, on peut lui concéder un minimum après son mandat. Mais, penser que la meilleure façon c’est s’éterniser au pouvoir, c’est créer des problèmes difficiles à gérer. S’ils ont bien compris le message, ils ne devraient pas commettre cette erreur. Le Burkina est à un tournant, c’est-à-dire que le changement va se produire tôt ou tard. La question est de savoir s’il surviendra à la suite d’un dialogue démocratique ou d’une révolte. Je préfère la première voie, celle que certains qualifieraient de réformiste parce que je suis un homme de paix qui a vu l’expérience des révoltes où il y a aussi des limites. Il est préférable que nous dialoguions pour capitaliser les acquis et progresser. L’autre alternative, c’est le changement par la force avec tout ce que cela comporte comme aléas, violences, exactions.
Propos recueillis par Antoine BATTIONO et Aimé NABALOUM (Stagiaire)
Le Pays
Article publié le mardi 3 mai 2011
1551 lectures

 Voir tous les produits
Voir tous les produits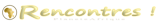



 Dernières publications dans cette catégorie
Dernières publications dans cette catégorie



