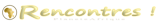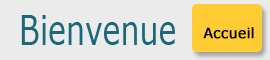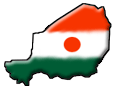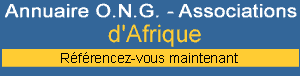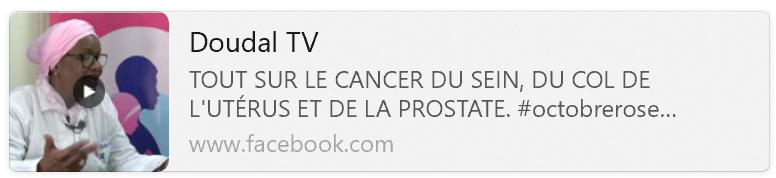Dans le contexte du Sahel Central et bien des cas celui du Niger, les effets du changement climatique se présentent comme des défis et beaucoup plus comme des opportunités qui s’offrent pour la mise en valeur et la gestion des ressources naturelles, dont l’eau, aux fins de productions agricoles maraichères et pastorales.
En cette mi avril 2025, mois le plus chaud de l’année, nous avons fait immersion dans les terroirs de cette zone à nappes sédimentaires alluviales de Gogo Machaya, où nous avons pu observer la transformation qui s’opère d’un village à un autre suivant l’offre d’opportunité et les autres facteurs déclencheurs en presence.
Située au Sud de la ville de Zinder, la zone d’investigation dispose du privilège historico systémique qui le lie à la Ville de Zinder et toute sa périphérie immédiate. En effet, depuis 1955, c’est de cette zone de Korama Gogo-Machaya que sont alimentés Zinder et les villages environnants.
Le trait de relation ecosystemique entre les 2 milieux, bien que contrariés et antinomiques, reste intangible et immuable. Il s’agit d’un lien vital, naturel, complémentaire et réciproque qui se matérialise physiquement, sous forme ligamentaire, en un parcours d’eau dénommé ruisseau qui prend naissance au niveau des collines qui ceinturent le Sud de la Ville de Zinder, d’Ouest en Est, du côté de l’Aéroport International, depuis le village de Dadin sarki jusqu’à Maïto et Garin mata.
C’est ce ruisseau qui charrie les eaux de pluies côté Sud de la ville de Zinder, Commune 1 et côté de Babantapki, Commune 5, pour les déverser après un parcours de 25 à 30 km dans la Korama, au niveau des stations de captage de Gogo et de Machaya alimentant les nappes qui servent, en retour, à fournir l’eau à la Ville de Zinder et les villages environnants et ce, depuis plus de 70 ans.
Pour cette zone choisie pour notre investigation rapide sur les opportunités créées par le changement climatique, il s’agit pour cette étude de bien connaitre les opportunités factuelles provenant des précipitations et des inondations causées en relation avec le retour de la période humide telle que annoncée par les experts du climat (DMN, CILSS, GIEC, NASA), ayant fait regorger les nappes, longtemps supposées taries et non rechargeables, à l’exemple de cette zone de Korama Gogo Machaya.
Ainsi, partant de ces objectifs et de nos observations au niveau des stations de Gogo, Machaya et des villages environnants, les effets des transformations climatiques et les opportunités de mise en valeur et de gestion des ressources naturelles dont l’eau, qui devient disponible et accessible, ne souffrent d’aucune contestation. La zone d’habitude sèche et desserte en cette periode chaude et sèche, grouille d’activités et non de moindre: des activités agricoles avec un paysage verdoyant de part et d’autre de la limite des berges des dépressions dunaires, entre les quelles faufile l’eau tantôt émergeant en surface, tantôt en faible profondeur, permettant une nouvelle dynamique des cultures irriguées dans la zone.
Les activités agricoles se poursuivent comme si nous sommes en pleine saison des pluies. Comment en est il possible ?
A priori et sur base de nos observations et échanges de terrain, la cause principale provient du retour des pluies en 2022, 2023 et 2024, qui ont impacté, en 3 ans seulement, l’environnement biophysique de cet écosystème de Korama Gogo-Machaya, s’étendant au Sud vers les villages de Daba, Kharé, Zongouna, Foulani1, Gaouna, Tchaliga, Garin toudou, Foulani2, Gogo, Danbowa, du côté droit et, sur le côté gauche, les villages de Incharouwa et Riga.
Et comme nous avons pu l’observer, les villages de cette zone sont en pleine transformation. Les initiatives foisonnent et les activités agricoles irriguées se créent en faveur du maraîchage, de d’élevage et même de la pisciculture.
Partout le long des dépressions, l’eau est à la portée et sa disponibilité assure la mise en valeur de terres dunaires longtemps exploitées uniquement sous cultures pluviales.
Avec la disponibilité de l’eau, les exploitants ont maintenu la dynamique laborieuse de système de production agricole irrigué, diversifié et échelonné, avec la culture des légumes, des céréales (riz et blé), des espèces fruitières, fourragères et les autres pratiques de resilience et d’adaptation, surtout l’élevage sédentaire, les techniques et pratiques performantes d’alimentation animale et l’embouche, dont nous avons pu témoigner, à notre passage dans la zone.
A la fin de ces investigations de recherche, il nous plaît de se satisfaire des éléments de recherche collectés et de l’importance et la qualité des résultats probants obtenus. Il faut le rappeler, la méthodologie de recherche déployée s’est basée sur la perception des acteurs et l’auto description de l’environnement, completée de leur auto analyse de la problématique sur les opportunités liées aux transformations environnementales dans le contexte de la zone Korama Gogo-Machaya étendue aux villages de Daba, Kharé jusqu’à Gaouna et Tchaliga d’une part, et d’autre part Incharouwa et Riga.
Ce qui a permis de recueillir des propositions d’amélioration et les pistes de développement inclusif et durable qui confortent nos connaissances sur les changements socio-écologiques et les dynamiques endogènes porteuses qui ont cours dans nos milieux et sociétés malgré la rudeur de l’épreuve des chocs et crises subie.
Assurément, au bout de cette recherche rapide, on constate que les opportunités aussi se créent, malgré le poids des crises climatiques et socio-économiques conjoncturelles et structurelles qui assaillent les communautés rurales de cette zone de Korama Gogo-Machaya.
A l’évidence, les acteurs locaux sont les plus prompts à les sentir et les adopter, si besoin est. C’est bien le binôme opportunité physique – acteur de terrain qui détermine la saisie de cette opportunité et son appropriation matérialisée par des stratégies de mise en œuvre dont prioritairement les acteurs de mise en œuvre sont plus en mesure de parler, de justifier leur décision en faveur de l’opportunité saisie et d’évoquer les motivations et les perspectives de leur penchant pour ces pratiques liées aux transformations environnementales observables dans la zone.
Enfin, pour que les informations collectées nous servent de contributions pour des actions et des projets realistes, bénéfiques et durables, les parties prenantes doivent s’inspirer des réalités factuelles et du choix motivé qui va laisser l’acteur de terrain jouer le rôle clé et preponderant d’acteur de mise en œuvre des actions de lutte contre les defis globaux pour assurer la durabilité impactante des actions et projets d’adaptation et de resilience qu’il choisisse d’adopter selon le contexte.
En complément à ce descriptif de recherche, nous vous invitons à plonger avec nous dans les documentaires vidéo pour vous imprégner de la perception des acteurs de terrain sur les opportunités liées aux effets du changement climatique en cours dans la zone.
1) Dr Haboubacar Maman Manzo, Enseignant Chercheur Université Boubakar Ba de Tillaberi au Niger, 2) Dr Dogo Seck Membre du Bureau de l’Académie des Sciences et Techniques du Sénégal et Professeur Mamadou Baro, Directeur du Bureau de Recherches Appliquées en Anthropologie (BARA) à l’Université d’Arizona aux USA.
21 Avril 2025.
Article publié le jeudi 24 avril 2025
839 lectures

 Voir tous les produits
Voir tous les produits