: Il y eut d’abord cette détonation dans le ciel de l’après-guerre. En 1952 paraissait Peau noire, masques blancs (1), « interprétation psychanalytique du problème noir ». Son introduction proclamait : « Nous ne tendons à rien de moins qu’à libérer l’homme de couleur de lui-même. Nous irons très lentement, car il y a deux camps : le blanc et le noir. »
L’auteur, Frantz Fanon (1925-1961), fut à la fois médecin psychiatre, essayiste, militant politique aux côtés du Front de libération nationale (FLN) algérien, dont il épousa la cause indépendantiste (2). Martiniquais, il fait partie de ces penseurs noirs dont la France a toujours du mal à accepter l’importance dans une histoire qui est pourtant celle de tous. Anticolonialiste radical, il demeure un intellectuel qu’il est préférable d’ignorer, en le taxant de « prophète raté (3) ». Pourtant, ce penseur à la plume hautement littéraire peut contribuer à éclairer non seulement notre histoire mais également nos débats et réflexions contemporains.
La thématique des « deux camps » évoquée par Fanon ne se limite pas à l’opposition entre ces deux couleurs de peau, mais s’inscrit dans le couple plus vaste des « oppresseurs » et des « opprimés ». Pour lui en effet, « une société est raciste ou ne l’est pas », et « le racisme colonial ne diffère pas des autres racismes ». Comme quand il cherche à traduire une idée-force et à en montrer le scandale, sa prose poétique et rhétorique se met en marche. La libération de l’« indigène » passe par son refus du monde de l’interdiction, par l’affirmation de son « je » nié par le colonisateur ne voyant qu’une masse informe et corvéable : « L’indigène est un être parqué, l’apartheid n’est qu’une modalité de la compartimentation du monde colonial. La première chose que l’indigène apprend, c’est à rester à sa place, à ne pas dépasser les limites. C’est pourquoi les rêves de l’indigène sont des rêves musculaires, des rêves d’action, des rêves agressifs. Je rêve que je saute, que je nage, que je cours, que je grimpe. Je rêve que j’éclate de rire, que je franchis le fleuve d’une enjambée, que je suis poursuivi par des meutes de voitures qui ne me rattrapent jamais. Pendant la colonisation, le colonisé n’arrête pas de se libérer entre neuf heures du soir et six heures du matin. » En d’autres temps, Paul Nizan écrivait : « Aussi longtemps que les hommes ne seront pas complets et libres, assurés sur leurs jambes et la terre qui les porte, ils rêveront la nuit (4). » Oppression bourgeoise en 1933, oppression coloniale en 1961.
Peau noire, masques blancs nous entraîne dans l’univers imparti au Noir, systématiquement conditionné par le Blanc. Pages passionnantes où l’héritage — malgré les divergences — des chantres de la négritude et du texte de Jean-Paul Sartre « Orphée noir » (5) se fait sentir, au travers des filiations lexicales métaphoriques et analytiques du corps, du regard. Fanon touche au plus près du corps, peut-être parce qu’il écrivit « la première mouture de ce livre en le (...) dictant, tout en marchant de long en large comme un orateur qui improvise ; le rythme du corps en mouvement, le souffle de la voix scandent le style (6) ». Mais avec Fanon la réalité prend le pas sur la métaphore : « (...) Au premier regard blanc, il ressent le poids de sa mélanine. » Des siècles d’esclavage, de colonisation ont figé le regard en induisant un rapport à l’Autre dont il est difficile, voire impossible, de se détacher : « Quand on m’aime, on me dit que c’est malgré ma couleur de peau. Quand on me déteste, on ajoute que ce n’est pas à cause de ma couleur... Ici ou là, je suis prisonnier du cercle infernal. »
Le racisme se traduit également par la façon de désigner le Noir. Lequel subit la connotation ancestrale de sa couleur, devenue évidence, quasi- essence : « Le noir, l’obscur, l’ombre, les ténèbres, la nuit, les labyrinthes de la terre, les profondeurs abyssales, noircir la réputation de quelqu’un ; et de l’autre côté : le regard clair de l’innocence, la blanche colombe de la paix, la lumière féerique, paradisiaque. » Le langage ne pourra s’expurger de ces connotations, de surcroît hautement religieuses : « Le péché est nègre comme la vertu est blanche. » L’analyse n’est pas neuve, y compris alors, mais, d’une œuvre à l’autre, Fanon va plus loin. Son dernier ouvrage, Les Damnés de la terre (1961) (7), démontre que la « compartimentation » de la société raciste et/ou coloniale génère obligatoirement la production d’un langage raciste : « Parfois ce manichéisme va jusqu’au bout de sa logique et déshumanise le colonisé. » Autrement dit, comme le dénonçait Sartre lors de la guerre d’Algérie (8), le système colonial en fait un « sous-homme ».
Fanon poursuit : « A proprement parler, il l’animalise. (...) On fait allusion aux mouvements de reptation du Jaune, aux émanations de la ville indigène, aux hordes, à la puanteur, au pullulement, au grouillement, aux gesticulations. (...) Cette démographie galopante, ces masses hystériques, ces visages d’où toute humanité a fui, ces corps obèses qui ne ressemblent plus à rien, cette cohorte sans tête ni queue, ces enfants qui ont l’air de n’appartenir à personne, cette paresse étalée sous le soleil, ce rythme végétal, tout cela fait partie du vocabulaire colonial. » Force est de constater que celui-ci n’a pas totalement disparu de nos latitudes, comme la chanson Le Bruit et l’Odeur (1995) (9) du groupe Zebda l’a rappelé.
« Les répressions, loin de briser l’élan, scandent les progrès de la conscience nationale » La « déshumanisation » de l’indigène justifie le traitement qui lui est infligé : « Discipliner, dresser, mater et aujourd’hui pacifier sont les vocables les plus utilisés par les colonialistes dans les territoires occupés. » La guerre d’Algérie n’est que la continuation paroxystique d’un système reposant sur la force et le mépris. Ainsi l’introduction de L’An V de la révolution algérienne (1959) (10) peut-elle souligner que, depuis le début de la guerre, « [le colonialisme français] n’a reculé (...) devant aucun radicalisme, ni celui de la terreur, ni celui de la torture ».
Mauvais calcul : « Les répressions, loin de briser l’élan, scandent les progrès de la conscience nationale », analysent Les Damnés de la terre. « Si, en effet, ma vie a le même poids que celui du colon, son regard ne me foudroie plus, ne m’immobilise plus, sa voix ne me pétrifie plus. Je ne me trouble plus en sa présence. Pratiquement, je l’emmerde. Non seulement sa présence ne me gêne plus, mais déjà je suis en train de lui préparer de telles embuscades qu’il n’aura bientôt d’autre issue que la fuite. » La libération physique induit la perte de la peur, la jetée à corps perdu dans le combat pour l’indépendance.
Dans quelles conditions ce combat va-t-il être mené ? Les Damnés de la terre postulent que « (...) la décolonisation est toujours un phénomène violent ». Car la violence appelle la violence, et quand celle de l’oppresseur envahit la moindre parcelle du territoire, difficile d’y résister pacifiquement : « Chaque statue, celle de Faidherbe ou de Lyautey, de Bugeaud ou du sergent Blandan, tous ces conquistadors juchés sur le s
Article publié le lundi 27 juillet 2009
2172 lectures

 Voir tous les produits
Voir tous les produits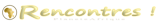


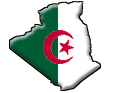
 Dernières publications dans cette catégorie
Dernières publications dans cette catégorie


