| |
 HYMNE À LA TOLÉRANCE
HYMNE À LA TOLÉRANCE
Bonjour
Ghislaine. Vous publiez votre nouvel ouvrage HYMNE À LA TOLÉRANCE. Son titre
est-il révélateur de son contenu? Est-ce une leçon de morale que vous donnez
?
Pas du tout ! Je n’aime pas donner des leçons de morale. En général ceux qui
donnent des leçons ne sont pas exemplaires (rires). Donner des leçons, c’est
quelque part une relation de pouvoir, c’est le désir d’empiéter sur les
autres. Quand on s’érige en donneur de leçons, on ne supporte pas de
rencontrer de la résistance. On veut imposer son opinion coûte que coûte. On
veut que tout le monde se plie à sa volonté et on se prend pour le nombril
du monde. On développe des stratégies pour forcer à obtempérer ceux qui ne
prennent pas nos propos pour des vérités d’évangiles. Il suffit de
rencontrer une opposition de la part de ceux qui n’y croient pas pour
arriver à des situations parfois dramatiques.
 L’écriture pour moi c’est une
relation d’échange, de partage et d’harmonie. Je n’impose rien, parce que je
n’ai pas le monopole de la vérité. Écrire pour moi c’est une relation
respectueuse et harmonieuse avec le lecteur. J’écris pour partager le fruit
de mon imagination avec les autres. Mais aussi pour entrer en contact avec
les autres. Hymne à la tolérance est un hymne à la paix. Un appel à
l’acceptation de la diversité. La tolérance dans toutes les relations
(amicales, fraternelles). La tolérance et le respect dans les relations avec
les autres. La tolérance devrait s’appliquer partout. Mais encore et
surtout, la tolérance évite les disputes et finalement les débordements. La
tolérance c’est aussi l’acceptation des différences. L’écriture pour moi c’est une
relation d’échange, de partage et d’harmonie. Je n’impose rien, parce que je
n’ai pas le monopole de la vérité. Écrire pour moi c’est une relation
respectueuse et harmonieuse avec le lecteur. J’écris pour partager le fruit
de mon imagination avec les autres. Mais aussi pour entrer en contact avec
les autres. Hymne à la tolérance est un hymne à la paix. Un appel à
l’acceptation de la diversité. La tolérance dans toutes les relations
(amicales, fraternelles). La tolérance et le respect dans les relations avec
les autres. La tolérance devrait s’appliquer partout. Mais encore et
surtout, la tolérance évite les disputes et finalement les débordements. La
tolérance c’est aussi l’acceptation des différences.
Hymne à la tolérance est-il un ouvrage qui s'inscrit dans votre pensée
littéraire habituelle ?
Oui. Comme je le disais déjà, j’écris pour communiquer avec les autres.
C’est seulement la façon de passer le message qui change. Je veux parler du
genre littéraire. Cette fois-ci, j’ai choisi le genre romanesque. Ce roman
raconte l’histoire d’une jeune fille ambitieuse et remplie de rêves
qui s’accroche aux études et cherche à échapper à la situation familiale
précaire dans laquelle elle vit. Malheureusement, elle se retrouve en
Occident et réalise que toutes les promesses faites pour convaincre ses
parents de la laisser partir n’étaient que du vent. Elle cherche à sortir de
ce gouffre car elle ne supporte pas de vivre en Occident et de ne pas aller
à l’école alors que dans son pays, elle était une brillante élève. Dans ce
parcours semé d’embûches, Isati, l’héroïne rencontre l’amour.
En écrivant Hymne à la tolérance, à quels publics le destiniez-vous ?
À tous les publics. La tolérance, comme je le disais déjà, c’est quelque
part l’acceptation des différences. Et ça c’est applicable à tout le monde,
enfants, jeunes, vieux... Aujourd’hui même au niveau des écoles primaires,
dans le cadre de la prévention de la violence, plusieurs ateliers se
donnent. Plus tôt commence la sensibilisation à une culture de paix,
meilleurs seront les résultats. La tolérance est finalement applicable
partout où il y a des relations humaines. Quand quelqu’un se sent rejeté, il
est frusté et c’est le début du cercle interminable de problèmes.
Vous avez déjà publié de nombreux articles dont « Quand des cultures
cohabitent, dialoguent et s'affrontent : la vie trépidante des immigrantes
africaines au Québec... » publié en avril 2004. Votre vie canadienne
est-elle la source de votre inspiration ?
Oui, je m’inspire beaucoup de l’environnement dans lequel je vis. Mais
l’Afrique reste aussi une source d’inspiration pour moi. L’éloignement
renforce quelque part mon attachement à mes origines et je puise dans mes
racines des outils pour entrer en contact avec les autres. Dans mon roman
Hymne à la tolérance par exemple, l’histoire commence en Afrique et se
termine en Occident.
Vous disiez à propos de la journée du 8mars : « ... la journée
internationale de la femme, ce n’est pas seulement le 8 mars… La journée
internationale de la femme, c’est tous les jours! Il ne faut jamais
abandonner nos rêves et persévérer dans ce que l’on fait ». J'ai le
sentiment que votre livre Hymne à la tolérance s’inscrit dans le droit
chemin de cette pensée.
C’est vrai que la journée de la femme ce n’est pas seulement le 8 mars. Tous
les jours les femmes ont des revendications à faire. Tous les jours il y a
des injustices. J’ai été engagée par un organisme ici pour participer à un
dossier sur la violence conjugale en milieu ethnoculturel. Il s’agit de
sensibiliser les hommes à la question de la violence. J’ai la confirmation
de ce que je savais déjà. En effet, je m’aperçois tous les jours que les
femmes sont confrontées à plusieurs problèmes. Et, si on devait attendre
seulement au 8 mars pour les régler, ce serait impossible de relever ce
défit.
Pour ce qui est des rêves, il faut y croire et tenir fermement le bon bout
pour les réaliser. Rien n’est facile dans la vie. Rien n’est donné sur un
plateau d’argent. Dans toutes nos entreprises, nous rencontrons des
difficultés, des obstacles, des trahisons, des peaux de bananes aussi, mais
il faut croire en ce que l’on veut et ne pas abandonner. La persévérance et
la patience sont les deux mots magiques pour la réussite dans toutes nos
entreprises. Quant au rapport avec mon livre, d’une certaine manière, oui la
tolérance rime avec la persévérance. La tolérance c’est quoi? C’est
l’acceptation de l’autre. La tolérance c’est comprendre qu’il faut de tout
pour faire un monde. La tolérance c’est comprendre que l’on n’est pas seul
sur la terre et qu’on ne peut pas imposer ses opinions à tout le monde.
Vous portez une attention particulière à la question des droits des
femmes. On a constaté que vous développez également une passion pour la
participation de la population à la vie municipale, comment expliquez-vous
cet intérêt ?
Effectivement j’ai un grand intérêt pour la politique municipale. En fait,
les articles que je publie sur la démocratie municipale s’inscrivent dans la
continuité de mon travail à la ville de Montréal. J’ai envie de dire que
c’est de mon travail que je tire les informations nécessaires. J’ai mené des
recherches pour la préparation du « troisième sommet des citoyens sur la
participation de la population sur l’avenir de Montréal » qui a eu lieu
du 17 au 19 septembre dernier à Montréal. J’ai également collaboré à un
document intitulé : la vie démocratique montréalaise : une revue des
grands dossiers. Nous étions trois chercheurs à travailler sur la
participation de la population montréalaise à la vie municipale sous divers
angles. Les résultats de nos recherches ont été publiés dans le document en
question.
Je suis passionnée par ce travail qui me donne l’occasion d’être en contact
avec des gens de milieux divers et variés. Disons que j’aime bien ce que je
fais alors j'ai pris l’habitude de publier des articles. Mon intérêt pour la
condition de la femme n’a pas changé pour autant. D’ailleurs comme je le
disais déjà, en marge de mon travail, je participe à une recherche sur la
violence conjugale en milieu ethnoculturel et nous menons un travail de fond
pour sensibiliser les hommes à cette problématique qui a des conséquences
dévastatrices sur les victimes.
Pouvez-vous nous parler de votre expérience au Canada.
J’ai quitté mon pays le 23 décembre 1995 pour Paris. Je n’ai subi aucune
pression pour quitter mon pays, heureusement pour moi. Pour ceux qui ne
demandent pas le statut de réfugié, le parcours est différent. C’est donc à
l’ambassade canadienne de Paris que j’ai effectué toutes mes formalités pour
l’obtention de mon visa d’études. Nous étions en famille avec un fils qui
avait deux ans à l’époque.
L’attente pour obtenir le visa a duré un mois. Durant l’attente de mon visa
j’ai perdu mon père qui prévoyait venir en France pour des soins médicaux. À
quelques heures de notre départ de Paris, puisque nous prenions le même
avion, il a décidé de rester pour partir une semaine plus tard à cause d’une
fièvre bénigne. J’étais persuadée de voir mon père et ma mère à Paris avant
mon départ pour le Canada. D’ailleurs, j’avais même laissé quelques bagages
qu’ils devaient m’apporter à Paris… Je tenais quand même à souligner cet
élément qui a été traumatisant pour la poursuite de mon périple. Mais je
vous épargne les détails! C’est donc en orpheline que j’ai pris l’avion pour
Toronto où je n’étais qu’en transit en direction de Montréal, car ma
destination finale était Sherbrooke. Nous sommes arrivés le 23 janvier 1996,
alors que l’hiver battait son plein. Je m’inquiétais beaucoup à cause du
froid. Bien qu’ayant passé quelques années en France, j’ai toujours eu des
problèmes avec le froid. Et puis, ici, l’hiver est infiniment plus rude
qu’en France.
Vous arrivez à Sherbrooke et...
… Et c’était assez déprimant et révoltant de recommencer ainsi la vie, de
s’acheter à nouveau ce que l’on a déjà possédé. Et ce qui était encore plus
pénible, c’était de se retrouver si loin dans un pays où l’on ne connaît
presque personne et surtout dans la situation de nouveaux arrivants. Bien
entendu, dans cette situation et durant cette période d’observation, il
était impossible de mener le même train de vie qu’au Congo. Il fallait
d’abord apprendre à connaître le pays, trouver le moyen de s’y adapter… Bien
évidemment, mon état d’esprit avait aussi des répercussions sur ma carrière
littéraire. Je ne peux pas dire que j’avais abandonné ma passion d’écrire
pendant cette période. Je pense même qu’elle a contribué à me donner la
force de tenir le coup. Toutefois, je ne pouvais pas donner le meilleur de
moi-même. J’ajoute aussi que dans un nouvel environnement, il faut être au
mieux de sa forme pour bénéficier de la confiance des gens et se frayer un
chemin… C’est valable dans toutes nos entreprises…
Lorsque ma pièce de théâtre « Les maux du silence » a été sélectionnée pour
être interprétée lors de la Marche mondiale de la femme, je vivais déjà à
Montréal. Comme par hasard, la pièce devait être jouée par le théâtre « Les
petites lanternes », une troupe théâtrale de Sherbrooke dirigée par Angèle
Seguin… Et c’est avec beaucoup d’émotion que je suis retournée à Sherbrooke.
Finalement un autre événement s’est ajouté aux nombreuses autres occasions
qui me lient encore à Sherbrooke.
Qu’est-ce qui a été le plus difficile ?
Dans ce nouveau pays, j’ai dû apprendre à m’occuper seule de mon enfant.
Aussi banal que cela puisse paraître, j’ai ressenti tout de suite la
différence. Ce n’est pas seulement le fait de passer des journées entières
seule avec mon fils qui m’oppressait. C’est surtout le fait que dans mon
pays, je bénéficiais de l’assistance de ma mère, ma grand-mère et des autres
membres de la famille. Comment ne pas ressentir le changement ? C’était une
période pénible. L’isolement contribuait beaucoup à rendre le contexte plus
dramatique et dégoûtant. J’en parlais à ma mère lors de notre rencontre en
France en 2001. C’était la première fois que je la rencontrais depuis que
j’avais quitté le Congo en décembre 1995. Quand je l’avais vue pour la
dernière fois, elle était encore une épouse. Et là, je retrouvais non
seulement une mère, mais aussi une veuve. C’est toute une différence !
Autre chose concernant vos « premiers pas » au Canada ?
J’ai vécu à Sherbrooke, une ville éloignée de la métropole, jusqu’en mars
1999. À mon arrivée à Sherbrooke, j’étais malheureuse. Je souhaitais vivre
dans une ville plus grande comme Montréal par exemple. Mais au moment de
quitter cette ville, j’ai eu un pincement au cœur. Oui un pincement parce
que je commençais à m’y habituer. J’en ai gardé des bons souvenirs et des
moins bons aussi. J’ai dû me rendre à Seattle aux USA, avec ma fille âgée de
deux ans alors que j’étais enceinte. Nous avions une entrevue avec
l’ambassade du Canada pour l’obtention de la résidence permanente. Il
fallait absolument remplir cette exigence pour continuer l’étude de notre
demande de résidence permanente car nous étions considérés comme des «
immigrants indépendants ». Les immigrants indépendants sont des personnes
qui présentent une demande de résidence permanente au Canada. Ces immigrants
sont évalués d’après un système de sélection qui tient compte de plusieurs
critères dont la scolarité, l’expérience professionnelle, la connaissance de
la langue (français ou anglais). Bref la liste est longue. En plus de tous
ces critères, il faut apporter la preuve que nous disposons des ressources
financières nécessaires pour vivre au Canada pendant une période donnée sans
avoir besoin d’une aide financière du gouvernement. Même si nous vivions au
Canada, il fallait déposer la demande dans une ambassade canadienne. Nous
avons choisi une ambassade aux États-Unis à cause de la proximité. J’ai dû
partir, laissant ainsi notre premier fils à Sherbrooke. Fort heureusement,
il y avait mon frère et des amis qui veillaient sur lui en notre absence. Là
encore, c’était une grande épreuve pour nous. Arrivés à Seattle dans la
nuit, notre préoccupation première a été de retrouver l’hôtel où nous avions
fait une réservation avant de quitter le Canada. Il nous fallait nous
reposer au plus vite pour ne pas être en retard à l’entrevue le lendemain.
Tout cela, dans mon état vulnérable de femme enceinte, avec ma fille dans
les bras qui ne savait pas trop ce qui se passait et surtout l’inquiétude au
ventre en pensant à ceux qui étaient restés seuls au Canada : mon frère et
mon fils. Nous étions chanceux dans notre « malheur » parce que ceux qui ont
moins de quatorze ans ne sont pas obligés de se présenter à l’entrevue.
C’est pourquoi mon fils qui était né du Congo ne nous accompagnait pas. Ma
fille m’accompagnait parce que je ne voulais pas prendre le risque de la
laisser. La seule solution était de « l’entraîner » dans cette aventure où
l’adrénaline était au maximum. Elle est née au Canada et bénéficie à ce
titre de la citoyenneté.
L’immigration c’est une aventure pleine de rebondissements, d’espoirs, de
faux espoirs et de désespoir parfois. En franchissant une barrière, une
autre se dresse. Il y a toujours une nouvelle barrière. Toujours un nouveau
défi. Ce n’est jamais fini! Nous avons quitté Seattle avec une incertitude
car tout n’était pas encore bien clair sur la décision de nous donner la
résidence permanente ou pas. Le stress était toujours présent comme avant le
départ, peut-être même plus. Enfin, ce n’est que trois mois plus tard, après
des pourparlers téléphoniques parfois infructueux et toujours angoissants
que la résidence permanente nous a été délivrée. Quelques jours seulement
après la validation de la résidence, j’accouchais de mon dernier fils, celui
qui m’accompagnait dans mon ventre au cours de cette aventure. Comme s’il
fallait que tout se règle avant sa naissance pour lui donner un peu de
repos. Comme s’il voulait en finir avant que l’on ne fasse « réellement
connaissance ». Ce fut un grand soulagement et le couronnement de gros
efforts et de sacrifices pour toute la famille.
Quelques années plus tard, j’ai passé un examen écrit pour devenir citoyenne
canadienne.
À cause du problème de reconnaissance des diplômes obtenus en dehors du
Canada et des États-Unis, j’ai été obligée, comme plusieurs immigrants, de
retourner aux études. Aujourd’hui, je suis détentrice d’une maîtrise en
science politique (ce qui équivaut à un doctorat troisième cycle) obtenue à
l’Université du Québec à Montréal.
Je peux en parler avec facilité à présent… Mais j’avoue toutefois qu’il
m’arrive de me demander comment j’ai pu « survivre » à toutes ces épreuves.
Un dernier mot ?
Oui. Vous remercier de m’avoir accordé cette charmante entrevue.
Ghislaine Sathoud -
PlaneteAfrique décembre 2004 |
|


 Voir tous les produits
Voir tous les produits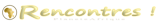




 HYMNE À LA TOLÉRANCE
HYMNE À LA TOLÉRANCE L’écriture pour moi c’est une
relation d’échange, de partage et d’harmonie. Je n’impose rien, parce que je
n’ai pas le monopole de la vérité. Écrire pour moi c’est une relation
respectueuse et harmonieuse avec le lecteur. J’écris pour partager le fruit
de mon imagination avec les autres. Mais aussi pour entrer en contact avec
les autres. Hymne à la tolérance est un hymne à la paix. Un appel à
l’acceptation de la diversité. La tolérance dans toutes les relations
(amicales, fraternelles). La tolérance et le respect dans les relations avec
les autres. La tolérance devrait s’appliquer partout. Mais encore et
surtout, la tolérance évite les disputes et finalement les débordements. La
tolérance c’est aussi l’acceptation des différences.
L’écriture pour moi c’est une
relation d’échange, de partage et d’harmonie. Je n’impose rien, parce que je
n’ai pas le monopole de la vérité. Écrire pour moi c’est une relation
respectueuse et harmonieuse avec le lecteur. J’écris pour partager le fruit
de mon imagination avec les autres. Mais aussi pour entrer en contact avec
les autres. Hymne à la tolérance est un hymne à la paix. Un appel à
l’acceptation de la diversité. La tolérance dans toutes les relations
(amicales, fraternelles). La tolérance et le respect dans les relations avec
les autres. La tolérance devrait s’appliquer partout. Mais encore et
surtout, la tolérance évite les disputes et finalement les débordements. La
tolérance c’est aussi l’acceptation des différences.