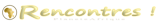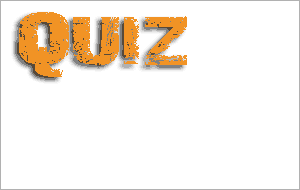Premier journaliste burkinabè à avoir remporté le prestigieux prix CNN, et plus de dix fois lauréat du prix Galian, Ouézen Louis Oulon, ancien directeur général de Oméga médias, est une légende dans le monde du journalisme. Directeur de la radio nationale (2009-2013), directeur de la télévision nationale (2014-2015), correspondant de Radio France internationale (RFI), correspondant régional de CNN et de la télévision allemande ZDF, qui de mieux que cet ancien pensionnaire des universités d’Oregon et de Maryland aux États-Unis pour analyser l’environnement actuel des médias ? Dans cet entretien réalisé, le 13 juin 2024, (Avant l’enlèvement du journaliste Serge Oulon, NDLR), il dit lire une détresse sur les visages des journalistes et des patrons de presse dans le contexte actuel burkinabè. Pour lui, les médias se portent mal et la corporation s’interroge. Selon l’éditorialiste, les journalistes sont à un carrefour où ils s’interrogent sur où aller et comment. « C’est comme s’ils étaient à un carrefour où ils ne savent pas s’il faut aller à gauche ou à droite ». Même s’il a souhaité ne pas se prononcer sur toutes les questions, le journaliste de CNN revient aussi sur son parcours dans le journalisme. Au sujet des prix Galian, il dit être souvent surpris de voir les jeunes confrères commencer un reportage en pensant aux Galian ou aux prix internationaux. Il les invite à plutôt être constants dans l’excellence au lieu de ne s’investir que pour les compétitions.
Premier journaliste burkinabè à avoir remporté le prestigieux prix CNN, et plus de dix fois lauréat du prix Galian, Ouézen Louis Oulon, ancien directeur général de Oméga médias, est une légende dans le monde du journalisme. Directeur de la radio nationale (2009-2013), directeur de la télévision nationale (2014-2015), correspondant de Radio France internationale (RFI), correspondant régional de CNN et de la télévision allemande ZDF, qui de mieux que cet ancien pensionnaire des universités d’Oregon et de Maryland aux États-Unis pour analyser l’environnement actuel des médias ? Dans cet entretien réalisé, le 13 juin 2024, (Avant l’enlèvement du journaliste Serge Oulon, NDLR), il dit lire une détresse sur les visages des journalistes et des patrons de presse dans le contexte actuel burkinabè. Pour lui, les médias se portent mal et la corporation s’interroge. Selon l’éditorialiste, les journalistes sont à un carrefour où ils s’interrogent sur où aller et comment. « C’est comme s’ils étaient à un carrefour où ils ne savent pas s’il faut aller à gauche ou à droite ». Même s’il a souhaité ne pas se prononcer sur toutes les questions, le journaliste de CNN revient aussi sur son parcours dans le journalisme. Au sujet des prix Galian, il dit être souvent surpris de voir les jeunes confrères commencer un reportage en pensant aux Galian ou aux prix internationaux. Il les invite à plutôt être constants dans l’excellence au lieu de ne s’investir que pour les compétitions.Lefaso.net : Que peut-on savoir du journaliste Ouézen Louis Oulon ?
Ouézen Louis Oulon : Comme vous l’avez dit, je suis un journaliste. J’ai été formé à l’université de Ouagadougou au département d’Art et Communication. Je suis de la première promotion de ce département avec un complément de formation à l’université d’Oregon dans l’État d’Oregon aux États-Unis d’Amérique et une autre formation obtenue à l’université de Maryland dans le même pays. J’ai été journaliste-reporter terrain, présentateur radio, j’ai assuré des chroniques hebdomadaires sur la santé pendant plus de douze ans. J’ai assuré la chronique politique et cinéma aussi. J’ai un background de journaliste scientifique, c’est l’une de mes spécialisations aux États-Unis. Sinon, je me suis beaucoup intéressé aux questions de société avec une orientation sur le journalisme d’investigation. J’ai tenté ce genre et cela m’a valu des récompenses sur le plan national et à l’international. Aujourd’hui, je suis content de voir qu’il y a une multitude de journaux d’investigation et de confrères qui mènent bien les investigations.
Après votre formation aux États-Unis, avez-vous eu des offres d’emploi là-bas ?
J’ai obtenu des offres intéressantes à l’époque qui m’auraient permis d’y rester. J’ai eu six mois de stage à la télévision CNN à Atlanta, des stages à Shorebank International à Chicago, à la VOA. Seulement, j’aime tellement le Burkina Faso que je me suis dit que deux ans de formation aux États-Unis c’est bien, mais je dois plus au Burkina où j’ai fait plus de quinze ans de formation que cette formation complémentaire. C’est cette raison qui m’a motivé à revenir. Aujourd’hui, il y a des confrères qui me disent que j’ai été une source d’inspiration pour eux. Je pense qu’il n’y a pas meilleure récompense que ce genre de propos. J’ai opté de travailler d’abord pour la fonction publique. Quand on voit les salaires et d’où on vient et comment on est arrivé à nous réaliser, on se dit qu’il a fallu un peu de bénédiction et de sacrifice aussi. Je ne suis pas sûr que beaucoup de jeunes aujourd’hui acceptent de le faire. J’échange souvent avec mes étudiants et je sais ce qu’ils pensent. Tout le monde veut démarrer avec un salaire de 500 mille FCFA. J’avais démarré avec un salaire nettement moins de la moitié de 500 mille francs. Ce n’est pas intéressant de mettre tout sur la place publique, mais je pense aussi que cela va permettre aux gens de réfléchir et de savoir que ces hommes qu’ils voient dans les médias, travaillent souvent.
Dans quel cadre avez-vous pu faire le voyage au pays de l’Oncle Sam pour les études ?
C’est à travers une bourse, sinon ce serait difficile pour moi de pouvoir m’inscrire dans une université américaine où la scolarité est en moyenne de 15 à 18 millions par an. Je suis parti à partir d’une compétition d’un programme que beaucoup connaissent, le programme Fulbright. La chance m’a souri et j’ai été sélectionné parmi les 153 meilleurs du monde entier. J’avais eu cette chance de représenter le Burkina Faso pour approfondir mes connaissances. J’insiste sur la formation au Burkina Faso, parce que les gens pensent qu’on se réalise quand on est allé à l’extérieur. Non ! J’ai fait les fondements de mon journalisme au Burkina Faso par des professeurs comme Serges Théophile Balima, Privat Roch Tapsoba, Jean Pierre Guingané qui nous ont donné les outils de la culture, des arts, de la communication et du journalisme. Cette université de Ouagadougou, je dois l’avouer, est une grande référence et constitue un extraordinaire laboratoire à fabriquer des cadres.
Comment est née votre passion du journalisme ?
C’est une passion d’enfance. J’ai eu la malchance pendant les vacances de CE1 d’être victime d’un accident de la circulation où j’ai malheureusement eu une fracture au pied gauche qui va m’immobiliser à quatre jours de la rentrée. J’étais cloué au lit pendant une période de trois semaines. Pendant ce temps, tout le monde sortait la journée et revenait me retrouver le soir dans une solitude. La radio était mon seul compagnon. Cela m’a donné une certaine envie d’être comme eux. Ma prédisposition pour le journalisme, c’est à mon CM2 que mes maîtres (enseignants) Paul Sawadogo et Tagnan Babou (par ailleurs mon maître scout), me l’ont dite. À l’occasion de mon certificat blanc (examen blanc), quand j’ai fini ma lecture, j’ai entendu que « il a une lecture journalistique ». C’était le déclic ! La passion se cultivant avec le parcours, à partir de ma classe de 4e au lycée de Manga où mon papa était affecté, j’ai eu l’initiative de créer une page d’actualité sur le tableau. Arrivés les matins, mes camarades lisaient ce que j’écrivais au tableau comme actualités. Je m’amusais à commenter aussi les matchs de football inter-classes. En classe de seconde au lycée de Pô, j’étais un chroniqueur sportif avec d’autres camarades, et on s’appelait par les noms de journalistes comme Alexis Konkobo, Victorien Marie Hien et autres. J’ai poursuivi les mêmes habitudes quand je suis venu à Ouagadougou pour faire la classe de première. C’est là qu’un de nos surveillants (monsieur Nassa que je salue au passage), qui a trouvé l’initiative très intéressante, m’a autorisé à afficher mes manuscrits sur le tableau officiel du lycée.
Après, il a demandé à la secrétaire de saisir pour afficher. Cela suscitait des attroupements à la récréation au tableau pour lire mes articles. Arrivé en terminale où il fallait choisir trois filières, je n’ai trouvé aucune qui concerne le journalisme. Alors que je me voyais déjà dans la peau d’un journaliste. J’ai décidé d’aller à la radio nationale pour me renseigner comment devenir journaliste. Je me rappelle avoir rencontré Baba Hama, Victorien Marie Hien, Réné Sebgo. Je leur ai demandé comment on devient journaliste. Étonné, René Sébgo me dit qu’il faut aller à Dakar au Sénégal, Lille en France… Sur les fiches d’orientation, j’ai noté quelque chose, dont je ne me rappelle plus. Quand les résultats du baccalauréat ont été proclamés, j’ai été malheureusement orienté au département d’anglais avec mon Bac D. À mon avis, je pense qu’il est bien de parler l’anglais, mais l’avoir comme seul savoir-faire était bizarre pour moi. Dieu faisant bien les choses, je suis tombé sur une note d’information annonçant le test de recrutement de journalistes pour Art et Communication. J’ai été retenu parmi les 30 candidats sur plus de 600.
Vous avez décidé d’abandonner l’anglais pour faire le journalisme et vous disiez aussi avoir un très bon niveau dans la langue. Avez-vous repris les études anglophones après ?
Quand j’ai atteint mon objectif, c’est-à dire faire le journalisme, j’ai décidé maintenant d’apprendre l’anglais. L’avoir comme savoir-faire à 100% n’ouvrait pas trop mes horizons, mais ne pas l’avoir dans mon métier limiterait mes capacités opérationnelles. Je me suis intéressé, bien qu’étant au département de communication en étant très assidu au cours, avec la regrettée Louise Compaoré. Après la formation au département, je suis allé m’inscrire aussi au Centre américain de langue pour améliorer davantage mon niveau en anglais. Mes camarades mêmes se moquaient de moi souvent parce qu’ils estimaient que je ne finissais pas de bosser. Naturellement, quand j’ai vu les opportunités de bourse, j’étais déjà préqualifié parce que, sur le plan linguistique, j’étais déjà prêt. J’avais réuni les conditions pour ce test.
De retour des États-Unis, comment s’est passée votre intégration dans le monde professionnel ?
L’un des contrats pour aller étudier, c’était de s’engager à revenir. J’ai plein de camarades qui ne sont pas revenus, mais moi j’ai décidé de revenir. Si tu ne rentres pas, on ne te remet pas ton diplôme et tu ne peux pas être naturalisé non plus. Je n’avais jamais planifié de rester là-bas. Pour mon retour au bercail, c’était une période morte parce que j’ai passé plus de douze mois à la maison. Les aînés comme Luc Adolphe Tiao, Mahamoudou Ouédraogo, le regretté Samuel Kiendrébéogo, ayant appris ma situation, ont mis tout en œuvre pour que je puisse reprendre le train de la production. En fait, j’ai commencé à travailler à la radio. C’est là-bas que j’ai fait aussi mon premier stage, c’était en 1993. En 1994 aussi pour mon deuxième stage. Quand j’ai fini mes études, j’ai intégré la maison entre 1999 et 2000 en tant que journaliste-reporter.
À vous entendre, vous avez côtoyé beaucoup de journalistes avant d’intégrer le milieu. Est-ce à dire que vous avez grandi avec des figures inspirantes ? Si oui, lesquelles ?
Absolument ! Quand je suis arrivé à la radio nationale comme stagiaire, j’ai été accueilli à la porte par un sympathique René Sebgo, mon rédacteur en chef. Il m’a souhaité bonne arrivée avant de faire le tour de la maison pour me présenter à ses collègues. Dans cette maison, j’ai rencontré des gens sympathiques comme Baba Hama (directeur à l’époque) qui venait souvent me féliciter pour mes reportages. J’ai eu l’occasion de côtoyer des bonnes personnes comme Danielle Bougaïré, Mafarma Sanogo, Lucie Kéré, Siriki Dramé, Issaka Ouédraogo, Gabriel, Victorien, Karim, etc.
L’accueil était tellement bien que je me sentais dans une seconde famille. Dès qu’il y a une situation, elles disent (les dames) qu’elles vont appeler leur beau (parce qu’elles toutes disaient qu’elles allaient me donner leurs filles). J’ai eu des aînés comme le regretté Yannick Laurent Bayala qui, après le journal, me donnait souvent 2 500 francs CFA. J’ai aussi un grand frère comme Newton Ahmed Barry qui, après son journal, m’embarquais dans sa Peugeot 205 pour déjeuner chez lui avant de revenir pour la conférence de rédaction. Je suis reconnaissant à toutes ces personnes qui ont contribué à mon épanouissement sur le plan professionnel.
En plus de nombreux autres prix Galian, vous avez remporté le prestigieux prix CNN. Parlez-nous de cette distinction.
Le prix CNN a été le premier prix international que j’ai remporté dans ma carrière. Je suis d’ailleurs le premier Burkinabè à remporter ce prix, c’était en 2004. J’ai vu l’annonce et j’ai décidé de postuler. Je savais que ma production était de qualité. C’était une enquête sur la prostitution à Ouagadougou. Un matin, j’ai reçu un appel de Christine Alloin de CNN Londres. Elle m’a informé que je suis finaliste du prix CNN. J’ai été invité pour prendre part à la grande cérémonie de remise à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le billet d’avion a été payé et j’ai voyagé en classe affaires aux frais des organisateurs et ça m’a vraiment donné envie de continuer dans ce métier, parce c’était une prestigieuse cérémonie précédée d’un séjour VIP de deux semaines où on s’occupe de vous comme des princes ; tout cela simplement parce que tu as bien travaillé.
Qu’est-ce que ce prix vous a apporté dans votre carrière professionnelle ?
Ce prix a beaucoup boosté ma carrière, parce qu’il m’a amené à une audience avec l’ambassadeur des États-Unis d’Amérique. Après le prix CNN, j’ai eu aussi le prix suisse des radios du Sud. Quand j’ai aligné les prix, le professeur Wetta, qui n’est plus de ce monde, a demandé de faire quelque chose pour moi. Une cérémonie a été organisée avec la population de Pô à cet effet. L’ambassadeur des États-Unis était venu. Il m’a demandé ce qu’il pouvait faire pour moi. Je lui ai dit d’offrir à mon village une école primaire, un collège pour mon département et l’ONG Corps de la paix pour la province du Nahouri. Il m’a rétorqué qu’il m’a demandé ce qu’il pouvait faire pour moi, pas pour ma province ou mon village. Je lui ai dit que la construction de cette école peut produire plusieurs talents comme moi. Il a accepté de financer la construction de l’école primaire par ses propres fonds. Quant au lycée, il a demandé des fonds au niveau fédéral et a promis de nous envoyer les Corps de la paix. L’école a été construite en trois mois.
Les prix Galian, vous en avez goutté les délices plusieurs fois. Qu’est-ce que cela vous fait de savoir que vous êtes auréolé de prix ?
J’ai en ai eu une dizaine. Chaque année, j’en remportais au point qu’en 2007, j’ai publiquement déclaré en direct que je me retirais pour laisser la place aux plus jeunes. Cela n’avait pas plu à mes amis et proches qui me blâmaient d’avoir refusé de l’argent. Si tu as remporté trop de prix, il faut penser à un moment que plus jeune que toi attend que tu libères le plancher.
Je tiens à souligner l’importance de ce prix Galian. Il permet au lauréat de sortir de l’anonymat dans une rédaction. Il y a des gens qui disent qu’on devrait permettre au jury d’observer les journalistes dans les rédactions, je ne suis pas d’accord avec cette façon de voir. Tous les prix à l’international, il faut déposer. Si tu penses que tu as une production de qualité, il faut déposer. Cela permet d’éviter qu’on dise que le ministère a fait des récompenses arrangées. Si c’était comme ça, les équipes de football pouvaient rester chez elles sans participer aux compétitions et dire qu’elles sont les meilleures. Si tu penses être capable, va dans l’arène pour montrer que tu l’es. On n’a jamais vu un film remporter les Oscars s’il n’est pas inscrit.
Quel est le secret de votre professionnalisme ?
C’est la permanence dans l’effort. Je suis désagréablement surpris de voir les jeunes confrères qui commencent un reportage en pensant aux prix Galian ou aux prix internationaux. Mon premier Galian m’a surpris. Je faisais comme d’habitude beaucoup de productions. Une fois, j’ai vu une conférence de presse du ministre Mahamoudou Ouédraogo qui annonçait les prix Galian. J’ai donc décidé de sélectionner quelques productions que j’avais eu à faire pour postuler, sinon je n’ai jamais réalisé un reportage en pensant uniquement à ce prix. J’ai eu le premier Galian avec mon reportage sur la crise de trône à Garango. Quand j’ai eu vent du prix CNN, j’avais trois bonnes productions. Là encore, j’ai choisi parmi elles, les travailleuses du sexe. Il ne faut pas que la qualité de vos reportages soient ponctuelles. Il faut la constance dans l’excellence. C’est comme dans la musique. Regardez Alpha Blondy, il chante depuis les années 1980. Mais quand il chante, tout le monde sait que c’est du Alpha. J’ai toujours demandé aux confrères de ne pas se précipiter boucler un reportage parce que le délai de dépôt est arrivé.
Quelle appréciation avez-vous des journalistes actuels ?
Je trouve qu’ils sont engagés, volontaires et passionnés de notre métier. Malheureusement, dans beaucoup de cas, ils sont sans repères par la faute des devanciers qui ont tous quitté les rédactions mais aussi des dirigeants qui n’ont pas su tracer une progression dans leur carrière.
Je suis content de voir autant de journalistes. Parmi eux, il y a du talent mais aussi il y en a pour qui la mayonnaise a du mal à prendre. À nos débuts (ce n’était pas l’Antiquité) les journalistes étaient comptés sur le bout des doigts. Aujourd’hui, avec le nombre assez remarquable de journalistes, cela fait qu’il y a un maillage du territoire. Avec les outils modernes, le travail devient facile. C’est une presse nombreuse et qui a des outils qui facilitent son travail. Malheureusement, c’est une presse qui ne fonce pas, c’est-à-dire aimer le travail et passer des heures sur le travail. Il y a des journalistes aujourd’hui, si on les met à la matinale, ils vont se plaindre. Moi j’ai assuré la matinale pendant trois ans en continu. Je l’ai fait avec Newton Ahmed Barry et c’était comme un jeu.
Et comment voyez-vous la pratique journalistique dans ce contexte de crise sécuritaire ?
Je lis une détresse sur les visages des journalistes, mais aussi sur les visages des responsables de médias. C’est comme s’ils étaient à un carrefour et ne savent pas s’il faut prendre la voie de droite ou de gauche. Actuellement, les journalistes sont à un carrefour où ils s’interrogent sur où aller et comment. Les médias se portent mal et la corporation s’interroge. Et pourtant, on est tous unanimes que personne ne pourra réinventer la roue du journalisme ! Je suppose que cette situation est temporaire, qu’on va arriver à la reconquête du territoire et que la plume va gagner en noblesse. Lire la suite
Interview réalisée par Serge Ika Ki Lefaso.net
Article publié le mardi 25 juin 2024
1074 lectures

 Voir tous les produits
Voir tous les produits