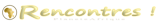Le magazine culturel
| Accueil - Archives - Inscrivez-vous - |
Suzanne DraciusAuteur, romancière, nouvelliste, poétesse, auteur de théâtre et professeur d’université, vous êtes considérée comme une femme de lettres complète. Parmi tous ces attributs, lequel revendiqueriez-vous le plus volontiers ? Peut-être celui qui correspond à ma production la plus récente, l’écriture de nouvelles. J’ai pris goût à l’écriture de ce genre littéraire sur commande : un jour le directeur d’une maison d’édition parisienne, Le Serpent à plumes, m’a dit qu’il aimait beaucoup L’AUTRE QUI DANSE, mon premier roman, édité chez Seghers (Robert Laffont), et m’a demandé si je voulais bien lui donner une nouvelle. J’ai dit d’accord, et le voilà qui me communique son numéro de fax ! Là j’ai dit : « Minute, papillon ! Je n’en ai pas encore écrit ! » Et voilà comment, en un week-end, je me suis adonnée à la composition de ma première nouvelle, « De sueur, de sucre et de sang ». Ensuite, c’est l’éditeur américain Houghton-Mifflin qui m’a demandé une nouvelle, puis une deuxième, et, comme par une initiation, le plaisir était en moi, il était entré en moi, dans l’enthousiasme, tel le « daimôn » socratique, et ne m’a jamais lâchée. La nouvelle est sensationnelle. Elle a tout du sensationnel. Parce qu’elle conte une histoire terrible sur un ton de folie, de cauchemar, de caprice ou de fantaisie, voire de fantasmagorie, produisant frissonnements, effets de saisissement, parfois même d’épouvante, de sorte qu’on a froid dans le dos en lisant les derniers mots, des picotements de rougissement, des décharges d’adrénaline. De toutes les sensations humaines, l’émotion est celle qui a le moins besoin du temps. La perplexité, la frayeur créées par un suspense palpitant s’affadissent lors d’une longue attente. L’acuité de l’angoisse s’émousse, si elle subit du « bois de rallonge », des longueurs et atermoiements, dispersions et digressions, lenteurs et prétéritions. Une nouvelle saisit, précisément parce qu’elle est courte. Mais je n’ai pas délaissé le genre romanesque pour autant. J’ai deux romans en cours d’achèvement. J’ai aussi la poésie au cœur : trois de mes poèmes font partie de l’anthologie HURRICANE, cris d’Insulaires (éd. Desnel, mars 2005). Quant à l’écriture théâtrale, elle s’impose également à moi, comme dans mon fabulodrame LUMINA SOPHIE DITE SURPRISE; en fait c’est selon le sujet, le thème abordé, que j’opte pour l’un ou l’autre des genres littéraires, au gré de mon inspiration. Certains ont vu en vous « la Maupassant des Caraïbes ». Cette appellation vous agrée-t-elle et considérez-vous qu’elle correspond à une réalité ?
Une nouvelle, qui n’est en fait que le récit d’un fait isolé, est d’une
grande richesse inductive. Pourtant elle n’est pas obligée de raisonner ni de
conclure, encore moins d’exposer une thèse. À partir d’un exemple ou d’une
expérience unique, on ne saurait induire aucun principe général. En revanche,
l’unicité même de l’expérience relatée et son caractère intensif peuvent servir
à poser, avec une pertinence intense, une importante question dont on n’a pas
envie de souffler la réponse, — du moins, pas péremptoirement. Dans « Les Trois Mousquetaires étaient quatre », je me libère et je marronne à l’occasion d’une singulière arrestation. Alors que mon personnage, menacé d’incarcération, harcelé par les policiers, refuse de « parler » et d’avouer, je me laisse partiellement dévoiler, de manière implicite, même si le narrateur y est sciemment occulté, et bien que l’énonciation utilise la deuxième personne, — ou peut-être précisément à cause de cette adresse à un(e) inconnu(e), interlocuteur-personnage et/ou lecteur. En effet, ce « tu » est acteur ; le héros, dans cette histoire, c’est « toi ». J’aime cette théâtralisation de l’éphémère, parfois de l’apparemment insignifiant. Il ne s’agit pas d’un texte dramaturgique à proprement parler, mais d’une nouvelle d’inspiration actuelle et de création récente. Or il se trouve que, dès l’incipit, à partir des toutes premières lignes, le texte se définit de lui-même ; instantanément la trame narrative se tisse, conférant aux événements une potentialité scénique en même temps qu’une possibilité d’identification, dans l’actualisation immédiate du récit. En effet, à l’instar de Maupassant, qui s’inspire, par exemple, de la guerre de 1870 et de l’invasion prussienne dans Boule de suif, dans RUE MONTE AU CIEL, souvent j’utilise l’artifice historique : 1902 (l’éruption de la Montagne Pelée), ou 2002 (le transfert de la dépouille d’Alexandre Dumas au Panthéon). Mais je me reconnais un autre maître : ce mulâtre dont je me sens proche. Comme le disait Dumas, pour moi « l’histoire est un clou auquel j’accroche mes histoires ». Je mets en arrière-plan les événements réels, cadres susceptibles de mettre en valeur les aventures fictives des personnages que j’invente ou que je métamorphose au gré de mon inspiration. Ou bien je puise dans l’histoire familiale, sociale ou locale de personnes ayant réellement vécu et dont je remodèle la vie. Je m’applique à raconter un petit fait individuel enchâssé dans la grande histoire humaine, ce qui lui confère une ampleur et une justification, de telle sorte que se pose quelque immense problème, à l’occasion d’une brève anecdote apparemment insignifiante, qui se développe dans la flamboyance. D’origine martiniquaise, il vous arrive, dans vos écrits, d’user de mots et de tournures typiquement créoles. Pense-vous que le créole puisse être considéré comme une source d’enrichissement pour la langue française ? En épilogue à ce recueil, RUE MONTE AU CIEL, la dernière nouvelle, intitulée « Écrit au jus de citron vert », illustre, sans le résoudre, le problème de ce que j’appellerais mon marronnage littéraire, — et de mon métissage culturel. N’y a-t-il pas antinomie et même antagonisme entre l’intelligence lucide, froide, cartésienne, si frigide qu’elle en est artificielle, et l’enthousiasme enfiévré d’une énergie créatrice hantée par quimbois et vaudous de l’imaginaire créole ? Jusqu’à quel point l’exaltation créatrice peut-elle prétendre avoir conscience de ses limites et de ses pouvoirs ? Au bout du compte, une telle conscience n’est-elle pas destructrice en soi ? (Qui a le dernier mot : « DELETE » ?) Métisse, 100% métisse, par ma personne et dans mon écriture, j’assume l’entièreté de mon héritage culturel multiforme. Créole, parce que née et élevée en Martinique, je trouve normal d’exprimer par des expressions créoles les « realia » de mon environnement et de mon imaginaire créole. Très vite mes souvenirs d’enfance se sont métissés de souvenirs d’En-France, mêlés aux réminiscences de mon île natale. Si le français est ma langue maternelle, le créole est ma langue paternelle. Je pénètre dans la langue française comme dans une habitation offerte, où, de mon île volcanique et de ma formation classique, font irruption la langue créole, la culture créole, mais aussi mes émotions vives pour ces langues dites mortes que sont le latin et le grec. Car, elles aussi, elles ont nourri ma culture et mes mythologies personnelles : ainsi m’amuserai-je à dire que je suis une mulâtresse calazaza gréco-latine. Je métisse tout cela dans une langue qui sûrement n’appartient qu’à moi, mais où tout lecteur se retrouve, car tout ce que j’ai écrit lui est rendu accessible, toute cette culture en métissage lui est offerte — par divers tours stylistiques dont vous me permettrez de garder secrète la recette. Oui, le français, que je respecte, notamment dans le maniement de sa syntaxe,
ne peut s’en trouver qu’esthétisé et exalté. N’ayons pas la mémoire courte, et débarrassons-nous de tout complexe. Le français, tel que nous le concevons aujourd’hui, est issu de la conjoncture historico-politique, du triomphe de la langue d’oïl, de la langue de la cour, sur la langue d’oc. Ce n’est qu’en 843 qu’apparaît le premier texte en langue « françoise », bien proche encore du latin, ainsi qu’en attestent les premiers mots de ce Serment de Strasbourg : « Pro deo amor… » Et, si ma mémoire est bonne, ce n’est qu’en 1539 que l’édit de Villers-Cotterets, ordonnance de François Ier — bien nommé ! — prescrivit l’emploi du « françois », le français, pour les textes officiels, jusque-là rédigés en latin. Quant aux colons français qui s’installèrent aux Antilles à partir du XVIIè siècle, ils ne parlaient pas le français de la cour, mais divers patois et dialectes des différentes provinces de France dont ils venaient ; de même que les esclaves déportés par la Traite négrière parlaient différentes langues africaines, parce qu’ils étaient originaires de différentes régions d’Afrique, — souvent, les maîtres prenaient soin de mélanger les différentes ethnies, afin de les empêcher de se fédérer. Les uns et les autres ne se comprenaient pas entre eux, si ce n’est, petit à petit, par le truchement de cette langue métisse qu’est la langue créole, née dans les habitations, sur les plantations, dans les « ateliers », les « jardins ». Experte de la langue française et brillante universitaire, comment voyez-vous l’évolution de notre langue dans les prochaines années ? À votre avis, a-t-elle encore un avenir ou, comme les dinosaures, est-elle condamnée à disparaître ? Une langue est quelque chose de vivant, qui se créolise au gré du temps. La langue créole comme les autres ! Cela ne veut pas dire disparaître. Le français n’est-il pas lui-même un créole de latin, du bas-latin de légions romaines parlé par des gosiers gaulois, enrichi d’un vocabulaire de formation savante par les lettrés gallo-romains, et à la grammaire fluctuante, tardivement codifiée par Vaugelas, il n’y a pas si longtemps, au XVIIè siècle, — non pour fixer, mais pour régler la langue, en prônant le recours à l’usage, fondé sur le « bon goût » de la cour et de la ville? Dans mon écriture romanesque, poétique et dramaturgique, le créole se fond au français, je chevauche allègrement français et créole, à plaisir. Cependant, pour certains poèmes, l’inspiration me vient en créole uniquement. Je ne voudrais pas être une Cassandre, ni prédire sa dilution progressive. J’observe seulement une évolution, une fusion avec d’autres éléments (l’anglais, l’argot, le verlan etc), notamment chez les jeunes de la Diaspora noire, pour qui le créole, les créoles, constituent un ciment identitaire, important pour se construire et se reconstruire. Les Antilles ont été un creuset dans lequel de nombreux peuples sont venus apporter leur patrimoine historique, linguistique, culturel et génétique pour donner naissance aux peuples antillais. À l’heure de la mondialisation et des regroupements géographiques, chacune des composantes du peuple antillais peut-elle espérer garder sa propre identité ou devra-t-elle se fondre dans une communauté pancaraïbe qui aurait le créole en partage ? On sait que le mot « créole » (de l’espagnol criar, élever), s’applique à tout être, — animal, végétal ou chose — né et élevé aux Antilles, aux maisons créoles comme aux « esclaves créoles », tels que l’on les nommait, aux XVIIè, XVIIIè siècles, par opposition aux Africains fraîchement débarqués. Nous en avons été dépossédés au XIX è siècle, par un tour de passe-passe, car ce terme fut réservé alors aux seuls colons blancs, — ceux que nous appelons les « békés ». Il s’agit, au siècle suivant, d’une véritable réappropriation de cette appellation, qui ne fait pas référence à une race plutôt qu’à une autre, ni à une nationalité, mais à une culture commune, un imaginaire partagé, voire un code linguistique qui crée une complicité. Les Sainte-Luciens, par exemple, communiquent avec nous, Martiniquais, en créole, de même que les Haïtiens, même s’il y a des variantes dans nos créoles respectifs, car ils ont conservé un créole à base lexicale française, du fait que ces îles, Ste-Lucie et l’ex-Saint-Domingue, ont été des colonies françaises. Nous gardons, cependant, nos identités respectives, ce qui me semble une excellente chose, féconde et riche d’apports multiples, pourvu que ce soit dans le respect de l’Autre. (Ce qui n’est pas toujours le cas, hélas ! Car l’immigration clandestine, en provenance d’Haïti, principalement, est farouchement combattue par les autorités et violemment rejetée par la population locale, en Guadeloupe notamment.) Face à la mondialisation, il se prépare actuellement un Forum Social Caribéen qui résoudra, je l’espère, bon nombre de ces problèmes. © Suzanne DRACIUS, mars 2005 |
:: En souvenir d'elles
La chanteuse capverdienne Cesaria Evora, surnommée la "diva aux pieds nus", est morte samedi à 70 ans dans son île natale de Sao Vicente, dans l'archipel du Cap-Vert. Cette fois, c’est sûr, il n’y
:: Thématique
Exilée depuis plus de 2 ans à Conakry, la diva de la musique ivoirienne, Aïcha Koné, respire la grande forme sur le plan artistique. Elle multiplie les spectacles à travers l'Europe et l'Afrique. Com...
:: Publiez sur ce site !
Invitation permanente : Vous êtes un Ami D'ici d'ailleurs, vous souhaitez paraître sur ce site, publier vos œuvres, votre collection... dans unes de ces rubriques, c'est facile, cliquez ici |

 Voir tous les produits
Voir tous les produits